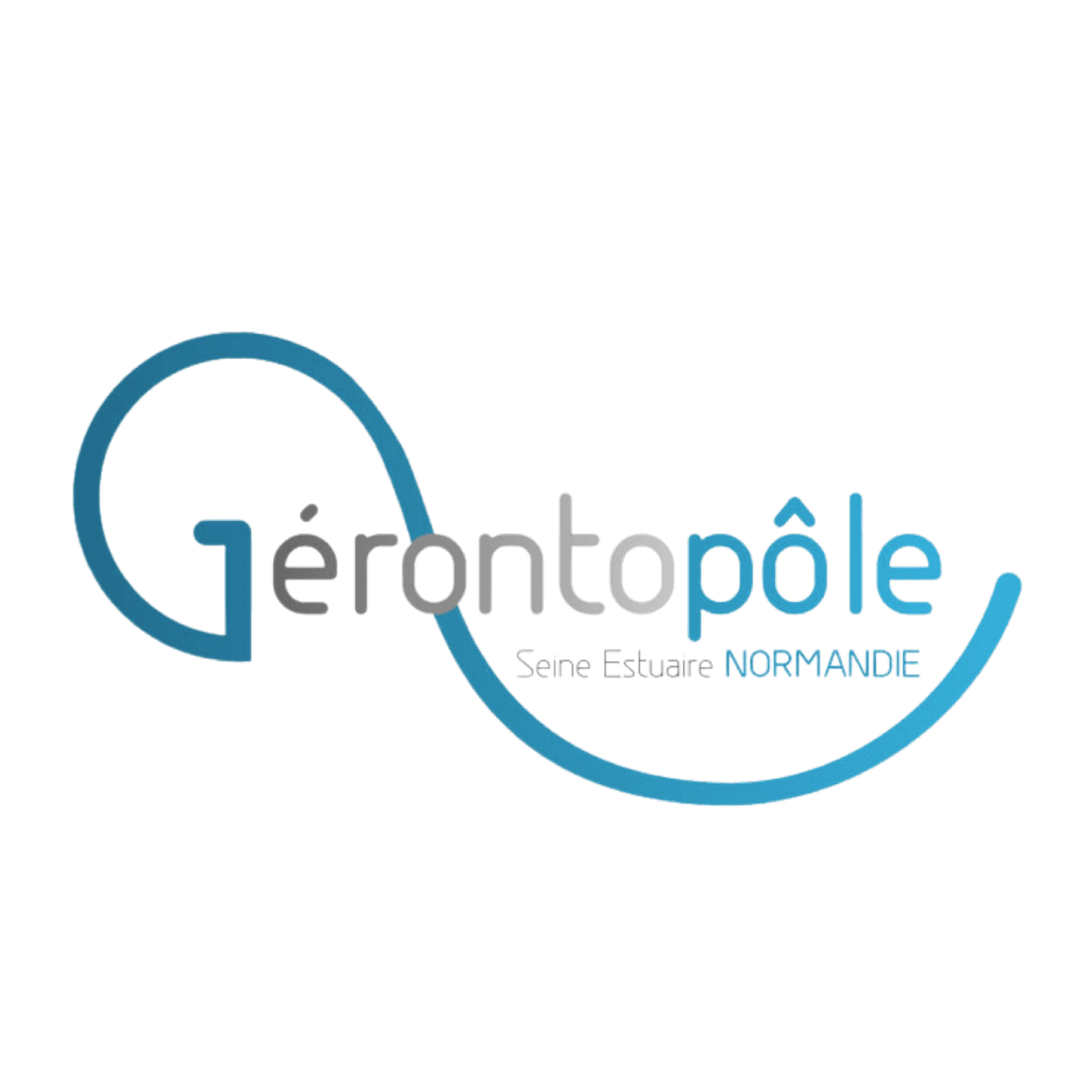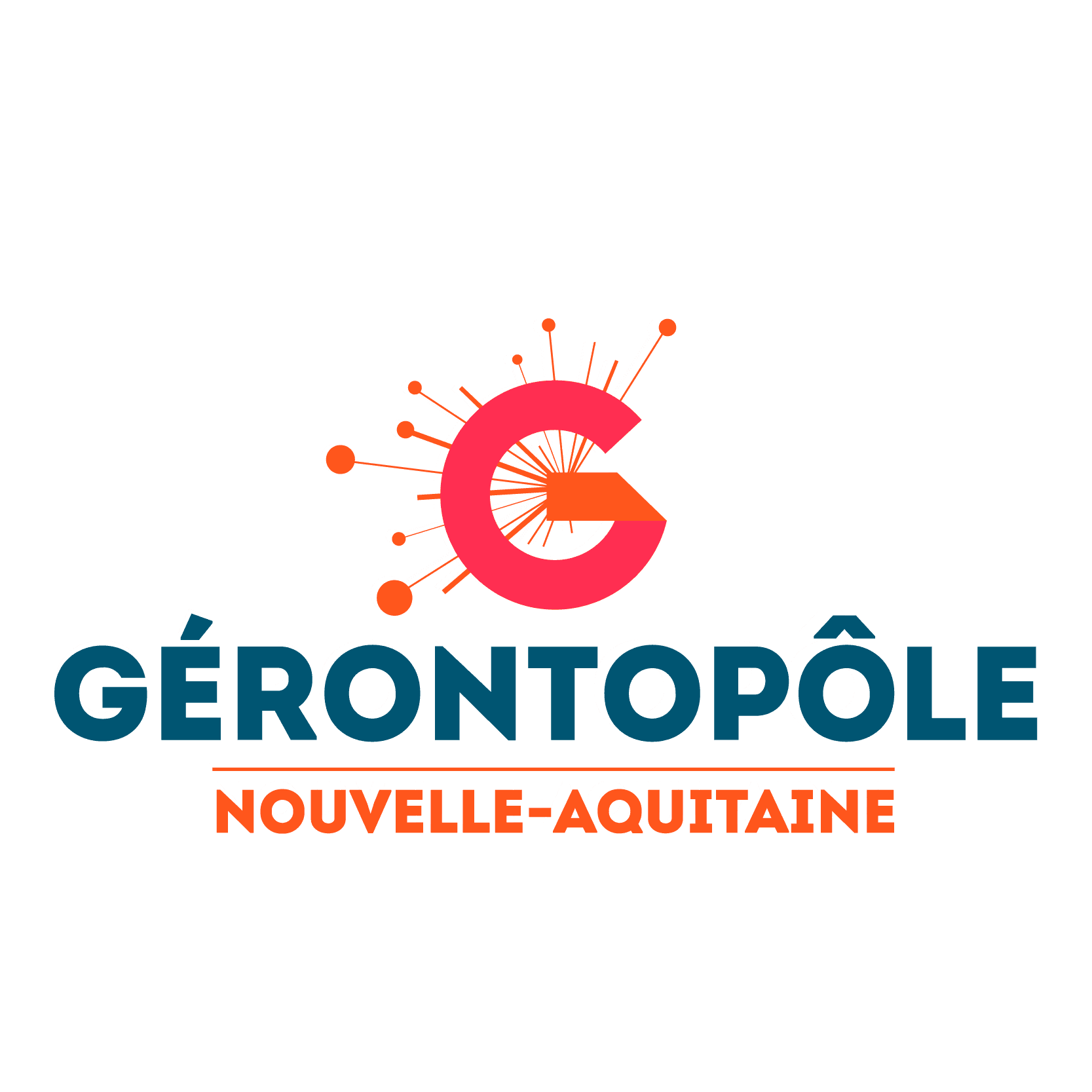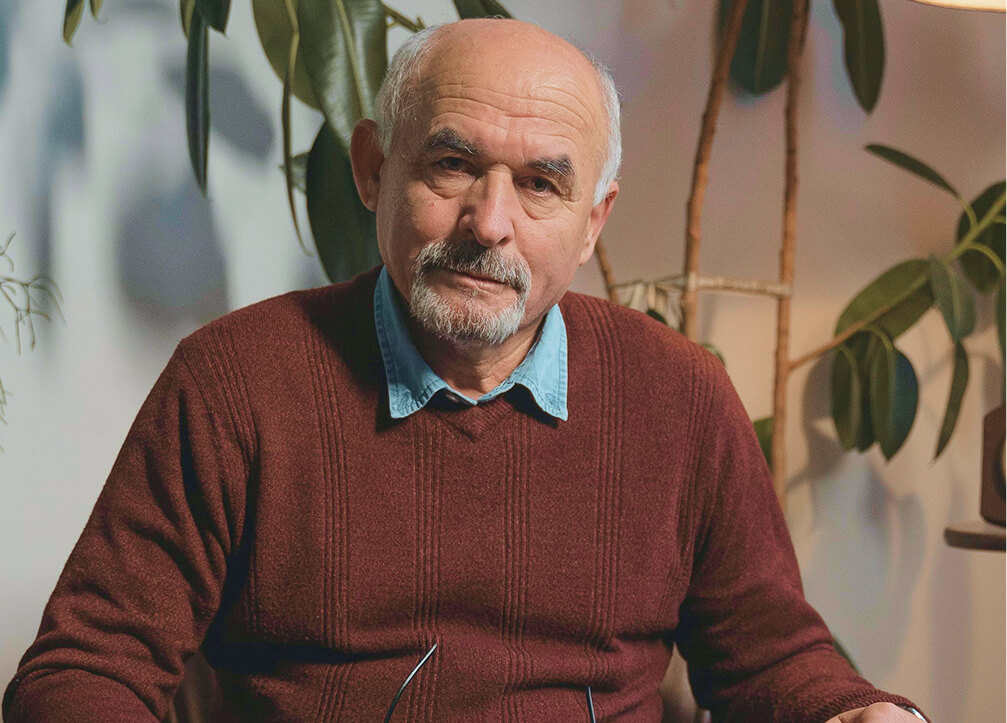La fracture du col du fémur est l’une des blessures les plus fréquentes chez les personnes âgées. Située au niveau de la hanche, cette fracture rend la marche impossible. L’âge avancé, l’ostéoporose, les troubles de l’équilibre et un environnement mal sécurisé expliquent pourquoi les aînés sont particulièrement exposés.
Sommaire de l’article:
Malgré l’âge ou la fragilité, remarcher après une telle fracture reste tout à fait possible.La récupération dépend du type de fracture, du traitement chirurgical, mais aussi de la motivation et de l’accompagnement mis en place. L’opération est généralement suivie d’une période de consolidation osseuse d’environ 6 à 8 semaines, puis d’une rééducation progressive, adaptée au rythme de chacun. Sous-estimé, l’impact psychologique est pourtant bien réel. Peur de retomber et perte de confiance rendent les personnes âgées vulnérables et résignées.
Même après 90 ans, il est possible de retrouver une certaine mobilité, à condition de respecter le rythme de la personne et de l’entourer efficacement. Le retour à domicile doit être préparé avec soin, avec parfois le soutien de dispositifs comme la téléassistance. Pour prévenir une nouvelle chute, quelques aménagements permettent de réduire le risque.
Qu’est-ce qu’une fracture du col du fémur ?
La fracture du col du fémur est une cassure osseuse localisée à la jonction entre la tête du fémur et le reste de l’articulation de la hanche. C’est une zone très sollicitée, notamment lors de la marche ou des mouvements de transfert (se lever, s’asseoir, monter un escalier). Lorsque cette partie se brise, la stabilité de la jambe est fortement compromise, rendant impossible de poser le pied ou de se tenir debout.
Ce type de fracture survient le plus souvent après une chute, même légère, surtout chez les personnes âgées dont les os sont fragilisés par l’âge ou l’ostéoporose. Elle peut également résulter d’un choc plus important chez les plus jeunes (accident de la route, traumatisme sportif), mais c’est plus rare.
On distingue plusieurs formes de fractures du col du fémur, en fonction de leur emplacement précis et de leur gravité :
- La fracture non déplacée (ou impactée) : les fragments osseux restent en place.
- La fracture déplacée : les morceaux d’os se séparent, ce qui nécessite souvent une intervention chirurgicale.
- La fracture sous-capitale ou transcervicale : elle se situe plus ou moins haut dans le col du fémur.
Pourquoi les personnes âgées sont particulièrement concernées ?
La fracture du col du fémur touche en grande majorité les personnes de plus de 65 ans, et plus encore après 80 ans.
Avec l’âge, les os perdent de leur densité, deviennent plus poreux, plus fragiles. Ce phénomène, connu sous le nom d’ostéoporose, est particulièrement fréquent chez les femmes après la ménopause, en raison de la baisse des hormones protectrices.
En parallèle, d’autres facteurs liés au vieillissement augmentent le risque de chute :
- Troubles de l’équilibre
- Diminution de la vue ou de l’audition
- Réflexes plus lents
- Fatigue chronique
- Médicaments qui altèrent la vigilance ou la tension
Peut-on remarcher après une fracture du col du fémur ?
Dans la grande majorité des cas, il est possible de remarcher après une fracture du col du fémur. La récupération dépend de plusieurs éléments :
- Le type de fracture (déplacée ou non, complète ou partielle)
- La solution chirurgicale retenue (prothèse, vis, plaques…)
- L’état de santé global avant la chute (présence de maladies chroniques, autonomie de base)
- La motivation de la personne et le soutien de l’entourage
Traitement et temps de consolidation
La fracture du col du fémur nécessite presque toujours une intervention chirurgicale. L’objectif est simple : stabiliser l’os rapidement. Le choix du traitement dépend de l’âge, de l’état de santé, et du type de fracture.
Les solutions chirurgicales les plus courantes :
- Ostéosynthèse : lorsque la fracture n’est pas trop déplacée, on peut la fixer avec des vis ou des plaques. Cette méthode conserve l’os naturel et permet une consolidation en quelques semaines.
- Prothèse partielle ou totale de hanche : dans les cas plus complexes, notamment si l’os est très abîmé ou s’il y a un risque de nécrose, on remplace tout ou partie de l’articulation. Cela facilite la reprise de la marche.
L’opération est en général réalisée dans les 24 à 48 heures suivant la chute, afin de limiter les complications liées à l’alitement.
Durée de la consolidation
La consolidation osseuse prend généralement 6 à 8 semaines. Le corps reforme progressivement du tissu osseux autour de la fracture. Ce délai peut varier selon l’âge, la qualité des os et le traitement choisi.
Rééducation : une étape essentielle pour retrouver la mobilité
La rééducation commence souvent très peu de temps après l’intervention, parfois dès le lendemain de l’opération, si l’état de la personne le permet. L’objectif n’est pas de retrouver immédiatement la marche complète, mais d’éviter l’immobilité prolongée et ses conséquences.
Un kinésithérapeute accompagne les premiers mouvements : se redresser dans le lit, s’asseoir, passer de la position couchée à debout avec de l’aide. Ce sont les étapes de base vers la reprise d’autonomie. Au fil des jours, on progresse vers des déplacements avec déambulateur ou canne, puis éventuellement sans aide.
Le travail porte aussi sur :
- Le renforcement musculaire, notamment au niveau des jambes et du dos
- L’équilibre, souvent altéré après la chute
- La coordination des gestes simples du quotidien
Chaque séance est adaptée au rythme de la personne, sans précipitation ni pression. La rééducation peut se poursuivre dans un centre de soins, avant un retour à domicile.
L’impact psychologique souvent sous-estimé
Au-delà des douleurs physiques et des contraintes liées à la chirurgie, une fracture du col du fémur peut avoir de véritables répercussions sur le moral.
Beaucoup de personnes âgées vivent cette chute comme un tournant brutal dans leur autonomie. La peur de tomber à nouveau devient fréquente et peut conduire à une perte de confiance dans les gestes du quotidien, voire à un repli sur soi.
Certaines personnes développent une anxiété persistante, un état dépressif ou une forme de résignation face à l’avenir. Le séjour à l’hôpital, la dépendance temporaire aux autres ou les changements d’environnement renforcent souvent ce sentiment de vulnérabilité.
Un accompagnement attentif – qu’il soit médical, psychologique ou familial – est essentiel. Encourager, valoriser les petits progrès et maintenir un lien social régulier aide à mieux traverser cette période délicate.
Fracture du col du fémur après 90 ans : quelles possibilités ?
À cet âge, la priorité est d’assurer le confort, la sécurité et la mobilité fonctionnelle, même partielle. L’objectif n’est pas forcément de revenir à une autonomie complète, mais de permettre à la personne de se lever, se transférer, se déplacer sur quelques mètres, avec ou sans aide technique.
Le traitement chirurgical reste envisageable tant que l’état général le permet. La reprise de la marche se fait plus lentement. Les séances de kinésithérapie sont adaptées à la forme du jour et ne visent pas la performance, mais la régularité.
Retour à domicile ou en structure spécialisée : quelles solutions ?
Après une fracture du col du fémur, le retour à domicile n’est pas toujours immédiat. Le choix entre un séjour temporaire en établissement ou un retour rapide à la maison dépend de plusieurs éléments : niveau d’autonomie, état de santé général, environnement domestique et présence d’aides.
Le passage en centre de rééducation
Ce type de structure propose un suivi médical régulier, une équipe pluridisciplinaire (médecin, kinésithérapeute, infirmier, ergothérapeute) et un accompagnement quotidien.
L’objectif est d’assurer :
- La poursuite de la rééducation dans un cadre sécurisé
- La surveillance des paramètres de santé (tension, douleurs, traitement)
- La préparation à un retour chez soi dans de bonnes conditions
Un retour à la maison bien préparé
Si la personne souhaite rentrer chez elle, il est important d’anticiper certaines choses :
- Mettre en place des soins à domicile (infirmiers, kiné)
- Prévoir une aide pour les tâches du quotidien (toilette, repas, déplacements)
- Adapter le logement (lit médicalisé, barres d’appui, chaise de douche…)
Un plan de retour à domicile bien organisé facilite la reprise d’un rythme de vie stable et évite les rechutes.
La téléassistance : une sécurité en plus
Pour les personnes âgées vivant seules, la téléassistance offre une présence rassurante. En cas de chute ou de malaise, il suffit d’appuyer sur un bouton pour joindre un opérateur et, si besoin, alerter les secours ou les proches.
Certaines solutions vont plus loin, avec des capteurs de mouvement, des détecteurs de chute ou des appels de suivi réguliers. C’est un bon complément pour garantir la tranquillité du patient et de sa famille, surtout dans les premières semaines de retour à la maison.
Prévenir une nouvelle chute : conseils pratiques
Après une fracture du col du fémur, la prévention des rechutes devient une priorité. Une deuxième chute peut avoir des conséquences plus lourdes encore, tant sur le plan physique que psychologique.
Sécuriser l’environnement à la maison
Adapter le lieu de vie est la première étape. Quelques ajustements suffisent pour limiter les dangers :
* Retirer les tapis glissants et les fils électriques au sol
* Installer des barres d’appui dans la salle de bains et près des toilettes
* Équiper l’escalier d’une rampe solide
* Améliorer l’éclairage, notamment dans les couloirs ou la chambre
* Placer les objets du quotidien à portée de main, pour éviter les étirements ou les déséquilibres
Mieux s’équiper
Le choix des chaussures est essentiel. On privilégiera :
* Des chaussures fermées, stables et antidérapantes
* Des semelles adaptées au sol de la maison (éviter les pantoufles usées ou ouvertes)
* Une canne ou un déambulateur si besoin, toujours bien réglé à la hauteur de la personne
Rester actif, tout en douceur
Bouger régulièrement permet d’entretenir les muscles, la souplesse et l’équilibre. Il ne s’agit pas de faire du sport intensif, mais de pratiquer une activité adaptée : quelques pas dans la maison, exercices avec un kiné, étirements simples…
Une séance quotidienne, même courte, aide à maintenir la mobilité et limite l’ankylose.